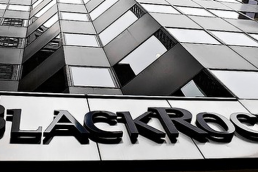Le mythe consistant à croire que l’introduction en Bourse consacre toujours durablement la réussite d’une société et constitue un événement irrémédiable de sa vie financière est battu en brèche par un regard en arrière sur l’historique boursier des 30 dernières années. Après avoir décrit le processus d’introduction en Bourse et les grandes phases historiques de levées de fonds lors des deux premiers actes du dossier AlumnEye sur les IPO, ce troisième acte revient sur la notion de performance de telles opérations financières.
Contrairement au mythe, la sous-performance n’est pas l’exception
Avant toute chose, à l’aune de quels critères peut-on juger du succès ou de l’échec d’une IPO ? Le nombre de cotations réalisées au cours d’une année ainsi que les montants levés indiquent à l’évidence une dynamique, mais ne disent rien de la performance, qui se mesure dans le temps et, idéalement, dans le temps long.
 Fondamentalement, sur le plan quantitatif, une IPO est un succès pour l’entreprise si elle permet de réaliser ses objectifs de financement de sa croissance, tout en préservant le patrimoine des actionnaires. A supposer que le montant initialement levé corresponde au besoin de financement ayant motivé l’opération, l’enjeu de la mesure du succès d’une IPO repose donc essentiellement sur ce second critère ; au niveau du marché, il convient donc de relever des signaux qui indiquent le sens des anticipations des investisseurs quant à la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs.
Fondamentalement, sur le plan quantitatif, une IPO est un succès pour l’entreprise si elle permet de réaliser ses objectifs de financement de sa croissance, tout en préservant le patrimoine des actionnaires. A supposer que le montant initialement levé corresponde au besoin de financement ayant motivé l’opération, l’enjeu de la mesure du succès d’une IPO repose donc essentiellement sur ce second critère ; au niveau du marché, il convient donc de relever des signaux qui indiquent le sens des anticipations des investisseurs quant à la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs.
Si l’on s’intéresse d’abord au temps court, les travaux de Jay R. Ritter soulignent que la performance moyenne à la fin du premier jour de trading des sociétés entrées en Bourse entre 1980 et 2019 aux Etats-Unis s’élève à 18%, en s’appuyant sur un échantillon de 8 610 IPO. Mais Ritter s’intéresse également au long terme. Considérant un échantillon de 8 286 sociétés cotées sur les Bourses américaines entre 1975 et 2015, il observe que la performance du cours de 56% des sociétés cotées est négative dans les cinq ans suivant leur IPO. Autrement dit, un investisseur qui aurait investi dans chacune de ces sociétés sur la période et conservé sa position pendant cinq ans aurait perdu de l’argent dans 56% des cas.
L’étude sur le long terme indique donc que la performance d’une introduction en Bourse ne va pas de soi. Le succès n’est pas toujours au rendez-vous, en particulier au cours de l’année 2021 puisque les données collectées par FactSet laissent apparaître que les titres de 66% des sociétés entrées en Bourse aux Etats-Unis ont terminé l’année en deçà de leur prix d’introduction. Sur Euronext Paris, ce chiffre grimpe à 79% ! Cette observation concerne aussi les plus grosses capitalisations, puisque Dealogic notait fin novembre que 49% des IPO ayant levé l’an dernier plus d’un milliard de dollars sur les places de Londres, Hong Kong, New York et en Inde présentaient également cette contre-performance, à l’instar du coréen Coupang et de la fintech américaine Robinhood, cotés à Wall Street, ou encore de Deliveroo à Londres, qui avait déçu les attentes immenses du marché en chutant de 26% lors de sa première séance fin mars 2021.
Il arrive, par ailleurs, que le surcroît d’attention lié à la préparation d’une opération d’introduction en Bourse soit lui-même source de bouleversements pour la société. C’est ainsi que l’annulation tonitruante de l’IPO de WeWork à la fin de l’été 2019 a violemment ébranlé la licorne américaine, conduisant son premier actionnaire, SoftBank, à pousser son excentrique CEO Adam Neumann vers la sortie et à engager un douloureux plan de restructuration. En effet, le travail des analystes sur les éléments financiers et les documents opérationnels de la start-up spécialisée dans la location d’espaces de coworking avait révélé les fragilités de son modèle économique et de sa gouvernance, faisant plonger sa valorisation anticipée de 47 milliards à moins de 10 milliards de dollars.
![]() Lire aussi : Dossier ECM : le processus d’introduction en Bourse (IPO)
Lire aussi : Dossier ECM : le processus d’introduction en Bourse (IPO)
Les IPOs : pas pour tout le monde, et pas sans contraintes
On comprend donc que les introductions en Bourse sont loin d’être systématiquement fructueuses. En effet, elles impliquent un certain nombre de contraintes qu’il convient de détailler :
- On l’a dit plus tôt, l’IPO confère de la liquidité aux actionnaires. Néanmoins, pour beaucoup de sociétés, leur taille modeste ne les rend pas éligibles à l’intégration des grands indices, à l’instar du CAC40 ou du S&P500. Elles disposent ainsi d’une plus faible visibilité sur le marché et ne peuvent pas en réalité revendiquer une forte liquidité de leur titre, hormis au moment même de l’introduction en Bourse. En effet, les titres small-cap ou mid-cap (dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros) ont tendance à être plus volatiles, car plus susceptibles de faire l’objet d’un désintérêt de la part des investisseurs institutionnels et donc de voir leur valeur déterminée par le passage d’ordres d’un nombre limité d’investisseurs ;
- Dans un papier publié dans la Review of Financial Studies, J. Asker, J. Farre-Mensa et A. Ljungqvist (2014) montrent que les entreprises cotées investissent significativement moins que les entreprises non cotées et sont moins réactives face aux opportunités d’investissement, étant soumises à une pression du court terme de la part des actionnaires. Autrement dit, les sociétés cotées sont bien plus tributaires des indicateurs financiers (croissance, bénéfice par action, dividende par action, etc.) et ne peuvent se permettre de faire l’économie d’une politique de communication financière bien rodée, souvent coûteuse, au risque de voir le marché se détourner du titre ;
- La cotation en Bourse expose également les entreprises aux attaques, qu’il s’agisse d’OPA ou de campagnes menées par des hedge funds qui pratiquent l’activisme actionnarial (prise en otage de la gouvernance d’entreprise pour stimuler le cours de Bourse, en prenant discrètement le contrôle d’une part minoritaire du capital) ou la vente à découvert (spéculation à la baisse sur le titre) pour mettre en évidence ce qu’ils considèrent être des dysfonctionnements en matière de gouvernance d’entreprise ou de stratégie financière, et ce afin de générer un profit ;
- Outre la contrainte de communication vis-à-vis du marché qui pèse sur l’entreprise, la cotation en Bourse implique également de fortes contraintes en matière de transparence envers les autorités de régulation (l’AMF en France, la SEC aux Etats-Unis, etc.) et de reporting financier, dans le but de protéger les actionnaires, ce qui génère des coûts ;
- Une introduction en Bourse classique, si elle n’implique pas de charges financières (intérêts), contrairement au financement par la dette, génère toutefois pour l’entreprise des coûts directs, notamment les frais de conseils divers et les frais d’underwriting prélevés par les brokers sur les montants levés par le marché (généralement moins de 3% en Europe et jusqu’à 7% aux Etats-Unis, où les marchés des capitaux sont dominés par un plus petit nombre de grandes banques d’investissement, les rendant ainsi moins concurrentiels), mais également des coûts indirects, tels que le manque à gagner issu du principe de la décote. Au total, Pascal Quiry et Yann Le Fur estiment le coût réel d’une IPO entre 15 et 20% du montant levé ;
- Le processus d’introduction en Bourse est relativement long, or le succès de l’IPO repose en grande partie sur l’humeur des marchés financiers, ce qui peut s’avérer problématique lorsque le processus d’introduction a été amorcé plusieurs mois auparavant.
Les sorties de cote volontaires sont fréquentes
 On constate donc que, dans sa philosophie même, l’introduction en Bourse tend à privilégier les actionnaires minoritaires (liquidité et protection statutaire), au détriment des actionnaires majoritaires (et de la gouvernance qu’ils ont mise en place). A ce titre, il est plus aisé de comprendre pourquoi certaines sociétés (comprendre, leurs actionnaires majoritaires) font le choix de quitter la cote, dès lors qu’elles considèrent que les coûts inhérents à la cotation excèdent ses bénéfices. En effet, si une grande part des inconvénients ou risques évoqués ci-dessus échappent parfois à la possibilité d’une mesure quantitative stricte de la performance (à la différence du montant initial levé ou de l’évolution du cours de Bourse), les coûts que ces derniers génèrent sont parfois jugés trop importants.
On constate donc que, dans sa philosophie même, l’introduction en Bourse tend à privilégier les actionnaires minoritaires (liquidité et protection statutaire), au détriment des actionnaires majoritaires (et de la gouvernance qu’ils ont mise en place). A ce titre, il est plus aisé de comprendre pourquoi certaines sociétés (comprendre, leurs actionnaires majoritaires) font le choix de quitter la cote, dès lors qu’elles considèrent que les coûts inhérents à la cotation excèdent ses bénéfices. En effet, si une grande part des inconvénients ou risques évoqués ci-dessus échappent parfois à la possibilité d’une mesure quantitative stricte de la performance (à la différence du montant initial levé ou de l’évolution du cours de Bourse), les coûts que ces derniers génèrent sont parfois jugés trop importants.
Une entreprise peut ainsi estimer qu’elle n’a plus besoin des avantages procurés par la cotation, par exemple si sa politique d’investissement actuelle ne nécessite plus les mêmes volumes que ceux engagés lors de son IPO et qui peuvent désormais être couverts par l’autofinancement, si la société jouit désormais d’une visibilité suffisante sur son marché, si la liquidité des actionnaires est jugée trop faible ou encore si la valeur boursière de l’entreprise est considérée trop inférieure à sa valeur fondamentale.
De façon schématique, si le choix est fait de retirer la société de la cote, il revient à l’actionnaire majoritaire de persuader la plupart des actionnaires minoritaires de lui vendre leurs titres, généralement dans le cadre d’une OPA (offre publique d’achat), jusqu’à atteindre un seuil de 90% du capital, dans le cas français. Ce processus implique pour le majoritaire de détenir les moyens financiers nécessaires pour racheter les parts des minoritaires. Le cas échéant, une procédure dite de « retrait obligatoire » est enclenchée sous la supervision du régulateur (en France, l’AMF).
![]() Lire aussi : La privatisation de la FDJ, un pari gagnant ?
Lire aussi : La privatisation de la FDJ, un pari gagnant ?
C’est le choix qu’ont fait les premiers actionnaires de deux des quatre principaux opérateurs téléphoniques français, Altice Europe (maison mère de SFR) en janvier 2021, suivi quelques mois plus tard par Iliad (Free), retiré de la cote par Xavier Niel en octobre, afin de mettre en œuvre son expansion internationale sans être bridé par les contraintes du marché. Toujours dans l’Hexagone, certains groupes choisissent parfois de retirer une filiale cotée en Bourse, à l’image de la sortie de cote par Allianz de sa filiale Euler Hermes (leader français de l’assurance-crédit) au printemps 2018 ou encore du retrait de Natixis de la Bourse de Paris par le groupe BPCE en juillet 2021.
 Le retrait de cote est également pratiqué outre-Manche. C’est là qu’en 2007, la première chaîne de pharmacies au Royaume-Uni, Alliance Boots, fait l’objet d’un LBO record en Europe, pour plus de 22 milliards de dollars, par plusieurs investisseurs, dont le fonds américain KKR, qui la retire du London Stock Exchange. La firme sera rachetée entre 2012 et 2014 par Walgreens, le leader américain du secteur, formant un nouvel ensemble nommé Walgreens Boots Alliance, qui sera coté au Nasdaq en décembre 2014. Il n’est ainsi pas rare qu’une sortie de cote soit choisie comme une solution temporaire, par exemple dans l’optique d’une restructuration. Le géant américain Dell Computers est ainsi sorti de la cote en 2013 dans le cadre d’un LBO réalisé conjointement par son dirigeant fondateur Michael Dell et le fonds Silver Lake Partners (on parle alors de MBO, Management Buyout) pour plus de 24 milliards de dollars, avant de retourner en Bourse sur le NYSE en 2018.
Le retrait de cote est également pratiqué outre-Manche. C’est là qu’en 2007, la première chaîne de pharmacies au Royaume-Uni, Alliance Boots, fait l’objet d’un LBO record en Europe, pour plus de 22 milliards de dollars, par plusieurs investisseurs, dont le fonds américain KKR, qui la retire du London Stock Exchange. La firme sera rachetée entre 2012 et 2014 par Walgreens, le leader américain du secteur, formant un nouvel ensemble nommé Walgreens Boots Alliance, qui sera coté au Nasdaq en décembre 2014. Il n’est ainsi pas rare qu’une sortie de cote soit choisie comme une solution temporaire, par exemple dans l’optique d’une restructuration. Le géant américain Dell Computers est ainsi sorti de la cote en 2013 dans le cadre d’un LBO réalisé conjointement par son dirigeant fondateur Michael Dell et le fonds Silver Lake Partners (on parle alors de MBO, Management Buyout) pour plus de 24 milliards de dollars, avant de retourner en Bourse sur le NYSE en 2018.
Ces sorties de cote régulières, souvent appuyées par des fonds d’investissement, soulignent l’attrait reconnu à l’investissement privé (comprendre, non coté) et la part croissante du Private Equity dans le financement des entreprises, phénomène sur lequel nous reviendrons dans la suite du dossier AlumnEye consacré aux IPO comme alternative possible, même si, on l’a vu, les deux outils ont souvent été utilisés de façon complémentaire. Ainsi, après avoir avoir décrit les notions de performance d’opérations d’introduction en bourse dans cet article, le prochain acte du dossier AlumnEye aura pour objectif de décrire un nouveau constat : la mutation du paysage des IPOs.
Nathanaël Zobel-Pantalacci, contributeur du blog AlumnEye
Articles associés
17 novembre, 2021
Qu’est ce que l’Equity Capital Market (ECM) ?
20 septembre, 2021
L’inflation, trouble-fête sur les marchés financiers
2 octobre, 2016
BlackRock, le succès d’un pionnier
29 août, 2013